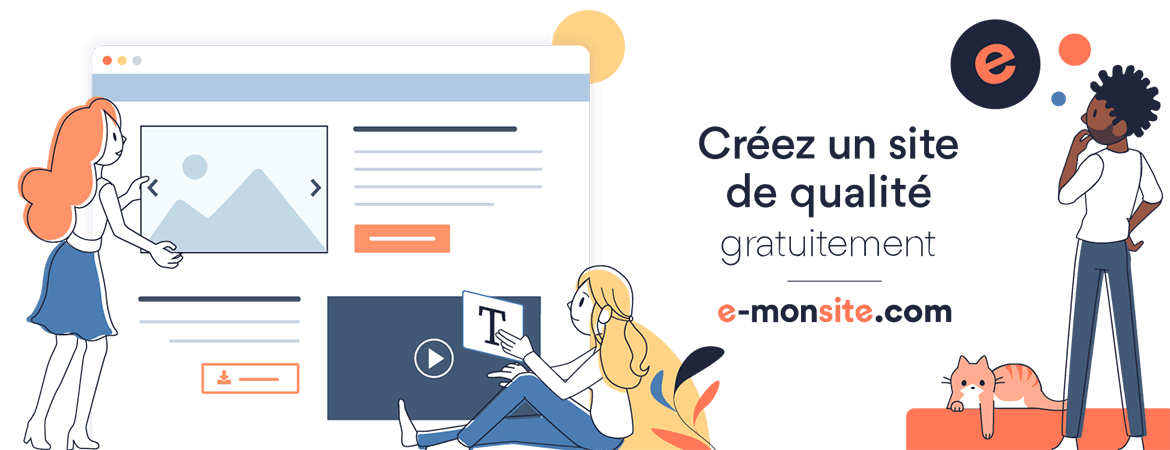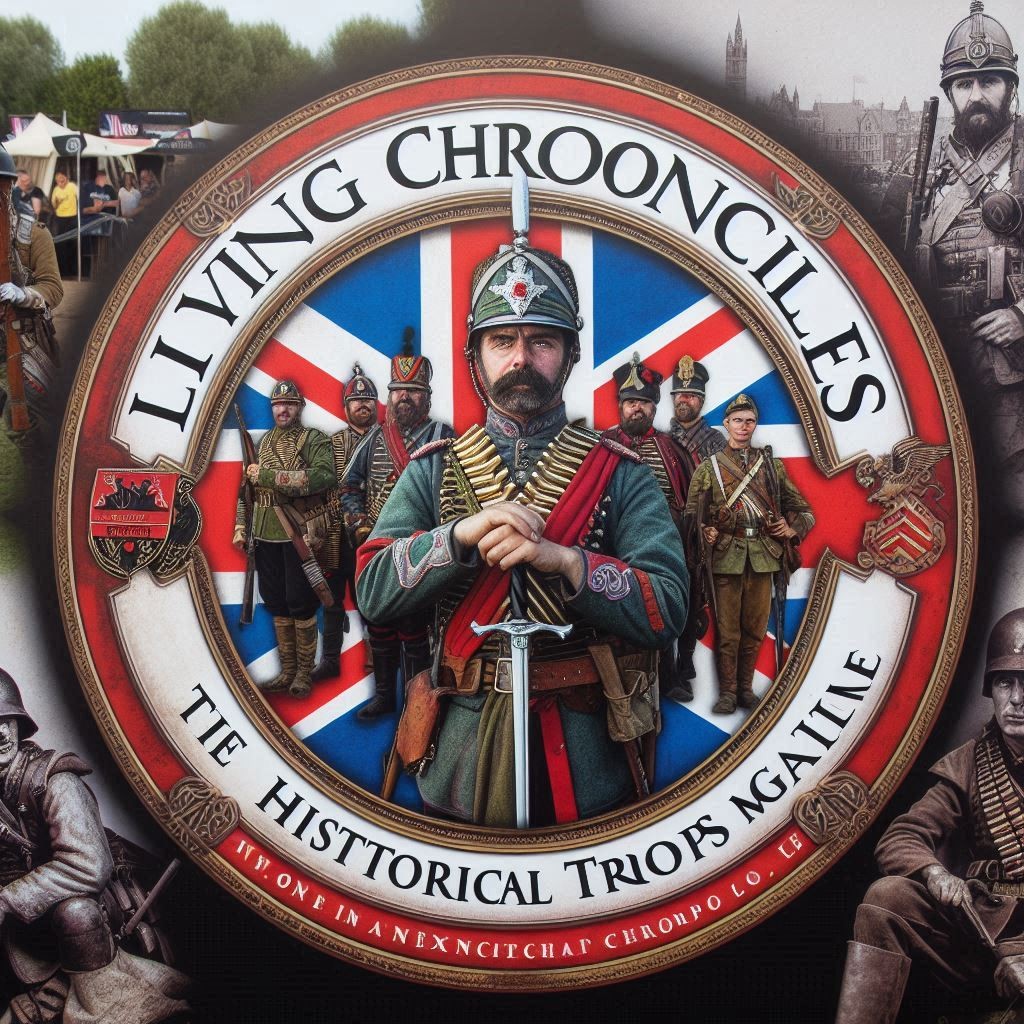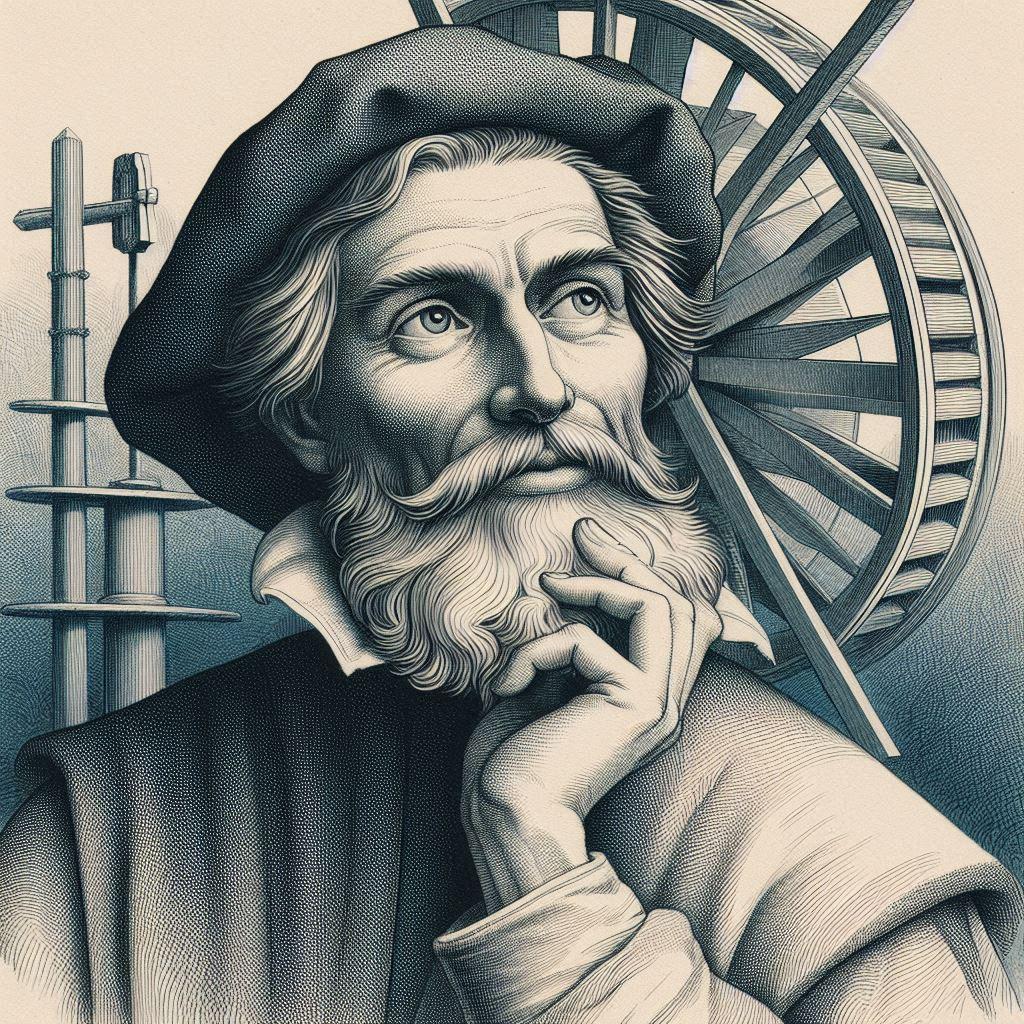12 Juin 1940 l’épreuve fatale de l’armée française
A l'occasion de l'exposition de La section France 40 véhicule de Vincy à Boularre dans le sud de l Oise et commémorait la bataille du 12 juin 1940 .. nous nous sommes intéréssés avec Éric Alary à la bataille du 12 juin 1940 .

Le 10 mai 1940, à la surprise générale, Hitler lance ses armées sur le front occidental. Le 22 juin, les forces françaises sont anéanties, et le maréchal Pétain signe à Rethondes un armistice humiliant. Comment expliquer ce désastre foudroyant ?La percée de Sedan : les panzers allemands traversent les Ardennes en mai 1940 • WIKIMEDIA COMMONS
Du 3 septembre 1939 jusqu’au 10 mai 1940, la « drôle de guerre », une non-guerre, a comme endormi les Français dans une atmosphère étrange. L’état-major français attend l’attaque allemande, emprisonné dans une conception défensive de la guerre. Or, en à peine six semaines, l’armée française, dont certains ont dit qu’elle était la plus forte du monde, est vaincue, écrasée, humiliée. C’est une guerre éclair (Blitzkrieg) singulière et traumatisante, qui a eu raison d’elle.
Pourtant, les Allemands n’ont jamais imaginé un tel scénario. En effet, le 10 mai, la Wehrmacht lance une offensive fulgurante sur l’ouest de l’Europe. Elle passe par les Ardennes avant de percer le front de Sedan, où les Alliés ne les attendent pas. L’effet de surprise, combiné avec les erreurs du haut commandement français, est la clé de la victoire allemande.
L’offensive du Führer
Hitler a décidé d’attaquer à l’ouest tôt ou tard, alors qu’il a envahi la Pologne en septembre 1939. Après des dizaines de reports, le Führer a pris la décision de lancer ses armées sur l’Ouest par une météo plus favorable et malgré les réticences de certains de ses généraux, qui savent que les Alliés ont autant de matériel, voire plus – encore faut-il qu’il soit opérationnel.
Le matériel allemand n’est pas très moderne : sur 157 divisions capables de combattre, seules 16 sont motorisées ; les autres avancent à la vitesse des fantassins, comme lors de la Grande Guerre. Toutefois, la force de l’attaque allemande réside dans la concentration d’un maximum d’avions et de chars blindés dans les Ardennes ; les Alliés n’ont ainsi pas le temps de rassembler leurs troupes pour barrer la route à la Wehrmacht.
Le commandement allemand est en outre très discipliné et l’utilisation combinée de toutes les armes ne leur pose aucun problème, tandis qu’en France seuls quelques officiers dans les années 1930, dont le colonel Charles de Gaulle, ont fait pression sur les autorités pour penser une stratégie offensive.
Le 10 mai, des parachutistes allemands atterrissent sur le sol hollandais et prennent les ponts et les fortifications frontalières. Des panzers épaulés par l’infanterie pénètrent aux Pays-Bas au même moment. Ils foncent alors vers Rotterdam. Cinq jours plus tard, les Hollandais capitulent. Parallèlement, sept divisions de chars panzers sont lancées vers le Luxembourg et la Belgique. Le 12 mai, les Allemands ont atteint la Meuse. Hitler est très surpris par de tels succès.
La ligne Maginot ne sert à rien
De son côté, le général Gamelin, chef des armées françaises, déclenche la manœuvre Dyle-Breda, mais tombe dans le piège du plan Manstein : les Alliés franco-britanniques se précipitent vers la Belgique quand les Allemands se ruent vers une zone où les fortifications massives n’existent pas. Contournée par l’ouest, la ligne Maginot ne sert à rien. Les Ardennes belges sont donc franchies sans grandes difficultés par la Wehrmacht et les avions de chasse.
Le 15 mai, les panzers sont à Sedan et à Dinant ; un « boulevard » se dégage, ce qui permet d’atteindre ensuite l’Oise, le 18. Les assaillants viennent de casser la ligne de front française et ouvrent une brèche de près de 90 km. Ils provoquent une panique sans nom sur les arrières de l’armée française, désorganisant totalement les communications. Le commandement français semble défaillant, incapable d’envoyer une armée de réserve pour empêcher les Allemands de marcher vers la mer et d’encercler les armées alliées situées au nord.
Français et Anglais essaient de contre-attaquer entre le 16 et le 22 mai. En vain. Abbeville est prise le 20 mai, et les côtes de la Manche sont atteintes la nuit suivante. Dans les Flandres, les Alliés sont pris comme dans une nasse. Le commandement allemand a réussi un coup de maître en coupant en deux les armées franco-britanniques.
Un espoir surgit avec une contre-offensive britannique du 21 mai au soir ; Hitler s’en inquiète et demande aux panzers de stopper leurs manœuvres qui consistent à essayer de rejoindre les ports de la Manche, entre le 22 et le 26 mai. L’infanterie est en retard derrière les chars. Les Allemands craignent de rester bloqués dans les Flandres. Hitler et les chefs allemands se souviennent avec effroi de la bataille de la Marne en septembre 1914, perdue, laissant s’échapper la possibilité d’entrer dans Paris.
Pugnacité des soldats français
L’armée belge capitule le 28 mai. Weygand, qui a remplacé Gamelin, a alors peu de moyens pour défendre un front de 280 km de long. Depuis le 26 mai, les chefs militaires alliés semblent incapables de rétablir un front continu. Pourtant, sur le terrain, les soldats se battent avec pugnacité, mais ils sont mal commandés, devant affronter ordres et contre-ordres permanents. Weygand échoue dans sa tentative de débloquer la situation dans les Flandres et de dégager les soldats alliés pris dans une nasse. Et puis les Français et les Anglais ne s’entendent pas toujours sur les décisions à prendre, ce qui fait perdre du temps face à des Allemands dynamiques et organisés.
Fin mai, 45 divisions alliées sont contraintes de se replier sur la région de Dunkerque. Près de un million de soldats alliés sont coincés dans les Flandres entre les unités de la Wehrmacht. L’arrêt des blindés allemands permet aux Alliés d’évacuer 338 226 soldats par la Manche – sur les plages de Dunkerque – entre le 26 mai et le 4 juin (opération Dynamo), dont 123 095 Français. Le 29 mai, 120 000 hommes ont pu être évacués, mais les avions allemands mitraillent les plages et les pontons d’embarquement ; ils coulent trois destroyers et 21 autres bateaux.
Près de un million de soldats alliés sont coincés dans les Flandres, pris au piège des unités de la Wehrmacht qui les rabattent vers la « poche de Dunkerque ».
L’opération, suicidaire en théorie, est possible grâce à la pugnacité de Churchill, parfois contre son propre cabinet de guerre. Il en appelle à tous les bateaux civils et militaires pour sauver des milliers de soldats de la capture à Dunkerque. Ils sont 370 à répondre à son appel. Cette évacuation donne lieu à des tensions très vives entre les commandements français et anglais. Les chefs anglais souhaitent rembarquer les soldats anglais en priorité, mais le Premier ministre britannique intervient le 31 mai, lors de la réunion du Conseil suprême interallié à Paris, en imposant d’évacuer aussi des Français.
Le 1er juin, des soldats français peuvent prendre aussi la mer. Les soldats alliés, trop nombreux, ne peuvent pas partir vers la Grande-Bretagne, faute de temps et de moyens d’embarcation. Les Allemands sont déjà dans les dunes de sable. Dunkerque est en grande partie détruite. Le 4 juin au matin, la dernière rotation est effectuée entre la France et l’Angleterre. Le drapeau nazi flotte aussitôt sur la rade.
Quelque 35 000 soldats alliés deviennent captifs des Allemands, tandis que 500 000 autres, piégés dans les Flandres, sont aussi faits prisonniers. En Grande-Bretagne, l’opération Dynamo renforce Churchill face à ses nombreux adversaires politiques. La catastrophe militaire française se poursuit en juin. Le « plan rouge » est lancé : les Allemands se déplacent vers le sud entre Montmédy et l’embouchure de la Somme.
Le bilan de la débâcle
Le 9 juin, c’est la rupture du front de la Somme. Le lendemain, l’Italie déclare la guerre à la France. Les Français ne font plus le poids, et les forces allemandes les surclassent. Malgré tout, les soldats français se battent avec courage entre le 5 et le 9 juin. Les Allemands opposent alors 104 divisions aux 64 françaises et 2 anglaises. Une fois la ligne de la Somme rompue, la Wehrmacht peut foncer sur Paris, envahie le 14 juin. Le 12 juin, les soldats français reçoivent des ordres de repli. Le 17 juin, les panzers de Guderian arrivent à Pontarlier. Près de 500 000 soldats français sont alors encerclés par Guderian dans la région de Belfort. Des unités de panzers continuent leur course vers le sud jusqu’au 25 juin, parfois sans combattre.
À cette date, les Allemands ont atteint, dans le Sud-Ouest, Angoulême, Cognac et Saintes et, à l’est, Aix-les-Bains, Romans-sur-Isère, Saint-Étienne, notamment ; au centre, Beaune, Le Creusot, Dijon, Nevers sont encerclés ou occupés par l’ennemi. La crise politique française est à son comble. Dans un message radiodiffusé, Pétain demande à Hitler les conditions d’un armistice, le 17 juin. Celles-ci sont terribles.
Le bilan de la débâcle militaire de 1940 est catastrophique pour l’armée française, alors que sur le plan matériel et humain elle faisait jeu égal avec les Allemands en 1939. Du côté français, près de 55 000 hommes sont morts et 123 000 blessés, entre le 10 et le 30 juin 1940. La Wehrmacht compte 30 000 tués et 117 000 blessés, ce qui prouve l’âpreté des combats. Si ces estimations sont inférieures à celles des premiers mois des combats de la Grande Guerre, les chiffres n’en restent pas moins impressionnants.
Entre 1 500 et 3 000 tirailleurs sénégalais ont été massacrés par racisme par les soldats allemands.
La campagne de mai-juin 1940 a été d’une très grande violence. De plus, les assaillants ont commis de nombreuses exactions sur les populations civiles du nord de la France après avoir terrorisé les Belges. Entre 1 500 et 3 000 tirailleurs sénégalais ont été massacrés par racisme par les soldats allemands. Le « coup de faucille » allemand jusqu’à la Manche, entre le 10 et le 20 mai est rapide. À partir de cette date, les Allemands enregistrent des pertes bien plus lourdes. Dans le département du Nord, la France perd 7 700 soldats, ce qui est le bilan le plus élevé de la campagne. Les batailles sur la Somme et dans l’Aisne se soldent par de lourdes pertes dans les deux camps. Du 10 au 20 juin, les soldats français se battent de façon acharnée ; les Allemands perdent plus de soldats qu’en mai. Les deux tiers des soldats – 1,8 million d’hommes – de l’armée française sont capturés ! Les Allemands ont aussi perdu beaucoup de matériel pendant les offensives : 29 % des Panzers et 32 % des avions ont été détruits. Ces avions feront en partie défaut à la Luftwaffe lors de la campagne d’Angleterre.
L’incapacité du commandement français
Sur le plan militaire, pourquoi une telle défaite ? Le grand médiéviste et capitaine de réserve (exécuté par les nazis en juin 1944) Marc Bloch a très bien résumé la situation, dans L’Étrange Défaite, rédigée pendant l’été 1940 : « Quoi que l’on pense des causes profondes du désastre, la cause directe – qui demandera elle-même à être expliquée – fut l’incapacité du commandement. » La classe politique française aussi a failli. Pour de Gaulle, qui lance son appel à la résistance depuis Londres le 18 juin, la défaite est due aux erreurs du haut commandement, surpris par la force allemande.
De son côté, Pétain cherche des responsables tous azimuts, sauf dans le monde des chefs de l’armée. Pour lui, les armées françaises ont perdu car les Français n’ont pas eu « l’esprit de sacrifice » et n’ont pas fait assez d’enfants pour rajeunir le pays depuis 1918. Il incrimine aussi le manque d’armes. Dans tous les cas, il a tort.
Ce ne sont pas les raisons premières de la crise militaire. Les deux armées sont à peu près égales en effectifs et en matériel en mai 1940. Les Français possèdent même plus de chars que les Allemands. Toutefois, ces derniers ont eu un avantage indéniable dans les airs avec les stukas. Les Alliés ont plus d’avions, mais beaucoup, à peine sortis des usines, ne sont pas opérationnels. Dans les années 1930, la France n’a pas consenti d’efforts assez importants pour équiper et moderniser ses armées. De même, quand les chars allemands, mieux reliés par radio, sont ravitaillés en carburant avec des bidons, ceux des Alliés le sont par de gros camions, ce qui est moins rapide.
La France, l’une des plus grandes puissances démocratiques du monde, n’a plus d’armée au terme de l’armistice franco-allemand, le 24 juin 1940.
Le haut commandement français a été dépassé sur le plan tactique, incapable de se relever de la surprise stratégique initiale. Il n’a pas su lire à temps la guerre de mouvement allemande ; les grands chefs avaient toujours la tête dans la guerre précédente. L’ennemi a su regrouper massivement un maximum de forces dans les Ardennes avec des avions de combat et des blindés. Les Français sont allés au contact de l’attaquant avec des forces dispersées, mal combinées. Pétain ne parlera évidemment pas de ces réalités, préférant culpabiliser les Français en incriminant leur prétendu relâchement et leur trop grande confiance dans la démocratie parlementaire.
La France, l’une des plus grandes puissances démocratiques du monde, n’a plus d’armée au terme de l’armistice franco-allemand, le 24 juin 1940 ; seule une petite armée de quelques dizaines de milliers d’hommes lui est concédée, « l’armée d’armistice ». L’impréparation d’une guerre moderne a coûté plus de quatre années d’occupation et de souffrances quotidiennes aux Français. Le pays est morcelé en plusieurs zones, et le pillage allemand commence aussitôt. Le pays est meurtri pour des décennies.
|
Pour aller plus loin
|
|---|
Ajouter un commentaire