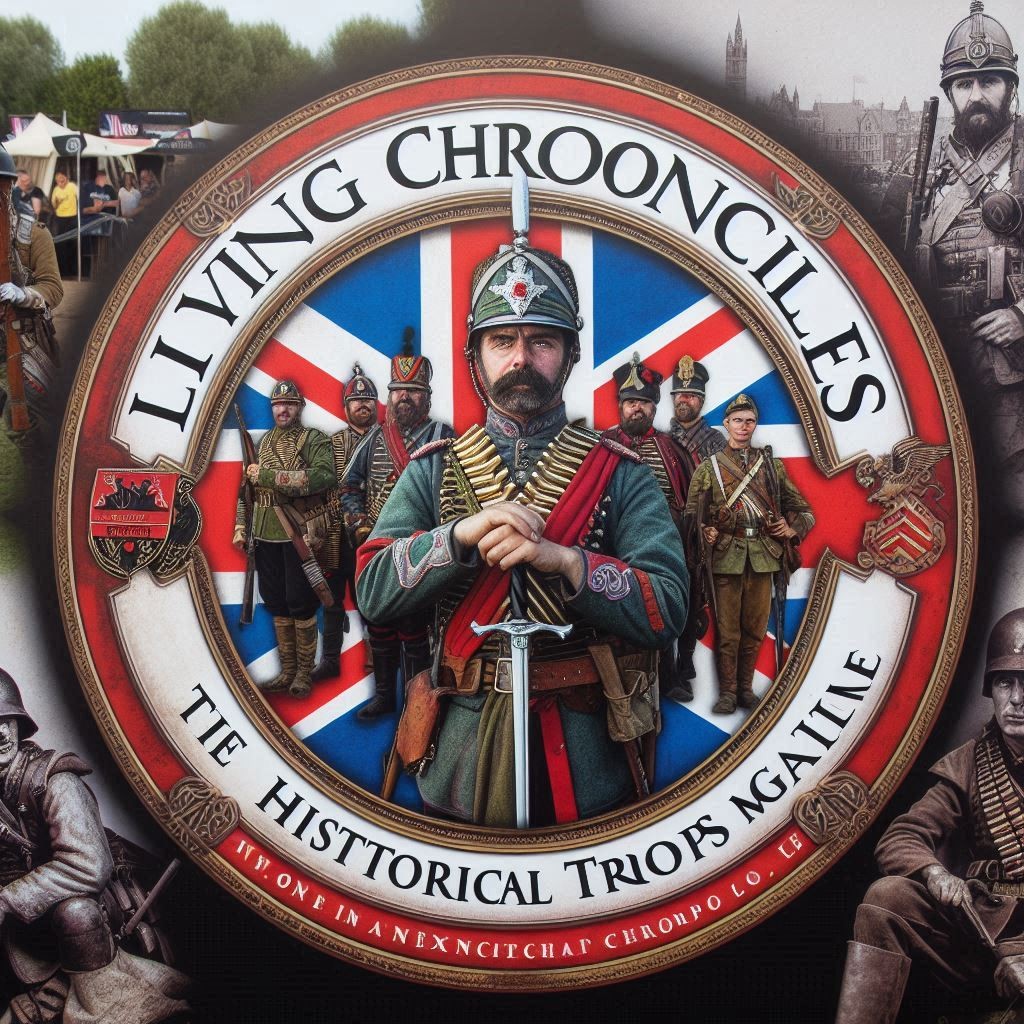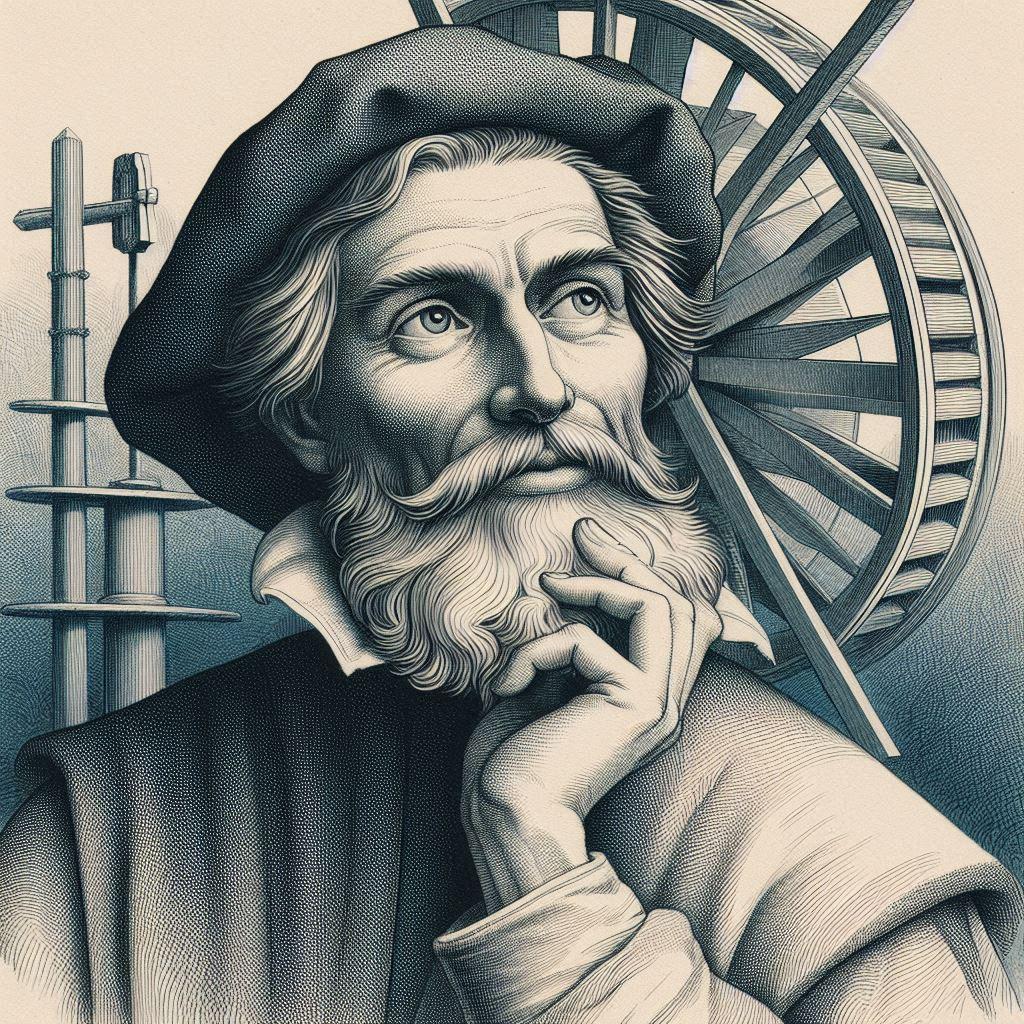La Légion romaine
Pour evoquer l'armée romaine nous allons nous referer aux recherches de l'Université de Nancy Metz
Les origines de Rome sont plongées dans les traditions et légendes, et l'armée archaïque des premiers rois traditionnels n'est assurément qu’un ensemble de milices privées au service de nobles qui se réunit autour d'un roi dans des cas exceptionnels. La phalange hoplitique (VIe — IVe siècles av. J.-C.) Rome passe ensuite sous la domination des rois étrusques et la première véritable armée nationale peut être considérée comme étant une armée étruscoromaine jusqu’à l'instauration de la République. Chacun doit payer son armement, les plus riches combattant à cheval ou constituant l'élite de l'infanterie, et les plus pauvres n'étant pas astreint au service, faute de moyens pour s'équiper. L'apparition de la légion manipulaire (IVe — IIIe siècles av. J.-C.)
Suite aux guerres incessantes auxquelles sont confrontés les Romains, l’armée se développe et évolue, et les besoins en effectif augmentent. Les hommes sont répartis en fonction de leurs revenus en classes censitaires puis la légion adopte l'organisation manipulaire, très moderne pour son époque, ce qui constitue une première révolution. Le corps de bataille éclate en une série de petites unités, les manipules, et gagne en souplesse. La solde est créée et les critères censitaires sont diminués : des hommes de plus en plus pauvres peuvent entrer dans l'armée, bien que légèrement équipés. 4) Des guerres puniques à l'époque des Grecques (IIIe — IIe siècles av. J.-C.) La deuxième guerre punique va mettre à dure épreuve l'armée romaine qui en sort vainqueur malgré un lourd tribut en hommes, et cette guerre aura de grandes conséquences à long terme. L'organisation militaire s'adapte et innove pour que l'armée puisse intervenir en dehors de la péninsule italienne sur de longues périodes, ce qui lance la lente professionnalisation de l’armée romaine avec des temps de service plus continu tout au long du IIe siècle av. J.-C. 2/8 - Fait par : MERTZ Thomas & THOMAS Alexis 5) La naissance d'une armée permanente au Ier siècle av. J.-C
. Les anciens alliés italiens deviennent citoyens, les procédures de recrutement et de mobilisation sont décentralisés et se basent dorénavant sur le volontariat et non plus sur les classes censitaires. La professionnalisation de l'armée prend de l'ampleur et les vétérans prennent une grande place dans la société. Les armées sont dorénavant enclines à servir les intérêts de leurs généraux aux ambitions démesurées qui partent à la conquête du pouvoir, ce qui mène la République romaine à son terme. 6) L'armée romaine impériale du Ier siècle au IIIe siècle Sous Hadrien, l’enrôlement des unités, légions et troupes auxiliaires de l’armée impériale se fait désormais strictement au niveau local, non seulement dans les provinces où ils tiennent garnison, mais au sein des agglomérations civiles annexées aux camps des frontières. Cette transformation entraîne la fixation des armées provinciales et la disparition de leur mobilité primitive. 7) L'armée romaine tardive du IIIe siècle au Ve siècle En 262, la réforme de Gallien interdit aux sénateurs de rentrer dans l'armée qui reste aux seules mains de l'ordre équestre. Gallien, la réorganise afin de créer des unités plus mobiles. D'autre part il se préoccupe de mieux utiliser les effectifs disponibles. Il constitue ainsi une armée mobile, le comitatus, en prélevant sur les légions des vexillations formées des éléments les plus aguerris. Une réserve de cavalerie est constituée en regroupant les pelotons de cavalerie affectés à chaque légion. L'empire est divisé en régions militaires, plus promptes à réagir aux menaces, et commandées par des comes rei militaris
l'organisation de l'armée Romaine

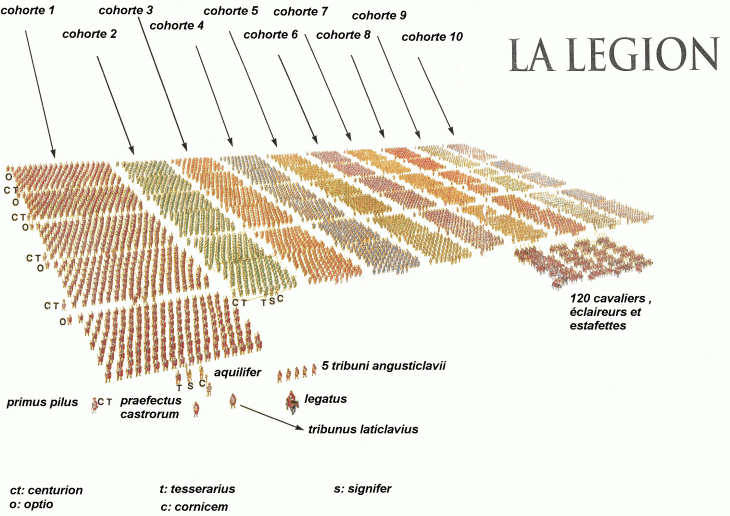
La première cohorte (à gauche sur le panneau) compte seulement 5 centuries de 160 hommes soit plus de 800 légionnaires. Elle regroupe l’élite de la légion.((Notre description correspond au portrait-robot d’une légion impériale telle que la définissent une majorité d’historiens))
Les neuf cohortes suivantes, numérotées de II à X ( de gauche à droite sur le panneau), se divisent chacune en 6 centuries de 80 légionnaires.
Un centurion (CT), secondé par un optio (O) commande chaque centurie. Elle possède un tesserarius (T), un signifer (S) et un cornicem (C ).
Ces centurions sont les vrais responsables des troupes pendant la bataille et au camp. Fines lames, rompus à toutes les ficelles, les ruses du combat au corps à corps, pétris d’expérience, ils avancent toujours en première ligne, à la tête de leur centurie.
Le Primus pilus, centurion de la première centurie de la première cohorte (tout à gauche) est le plus élevé en grade et a le privilège de participer aux réunions d’état-major. Tout légionnaire, tout centurion rêve de devenir centurion primipile mais il faut beaucoup de forces physiques et morales, de compétences, de bravoure, plus un brin de chance… pour rester en vie assez longtemps.
Le Tesserarius détient le mot de passe. Le Signifer ( ou porte-enseigne) porte le signum (enseigne) de sa centurie. Il montre le chemin à suivre dans la marche comme au combat. Au camp, il surveille l’argent, déposé dans la chapelle aux enseignes, et le marché où les soldats s’approvisionnent.
Les sonneries du cornicem (sonneur de cornu) mobilisent les porteurs d’enseigne que les légionnaires suivent immédiatement, aussi bien dans les rassemblements, la marche ou les batailles.
Une très lourde responsabilité pèse sur l’Aquilifer : Ce gradé porte l’aigle , symbole sacré de la légion, objet d’un véritable culte. Chaque légion possède un aigle !
La cavalerie, avec ses 120 cavaliers, sert d’agent de liaison, d’escorte et d’éclaireur.
L’état-major comprend
Un légat, nommé pour deux ou trois ans. Il commande la légion en veillant à la bonne marche des unités, en faisant respecter la discipline, pratiquer l’exercice, en assurant des pouvoirs financiers et judiciaires.
Un tribun laticlave, reconnaissable à la large bande pourpre qui orne sa tunique et indique son rang sénatorial. Ce deuxième personnage de la légion aide le légat dans ses fonctions judiciaires et dans la gestion de l’exercice.. Il peut aussi le remplacer.
Un préfet de camp, souvent un ancien centurion primipile, troisième personnage de la légion par ordre d’importance. Il supervise l’entretien du rempart, surveille les bagages pendant la marche et commande l’artillerie.
Cinq tribuns angusticlaves, ainsi nommés car leur tunique s’orne d’une bande pourpre étroite et signale leur appartenance à l’ordre équestre. Chacun mène au combat deux cohortes soit environ 1000 soldats et officiers. Ils participent aux réunions d’état- major, dirigent l’exercice sur le terrain, veillent à la sécurité des portes du camp, à un bon approvisionnement de la légion, au bon fonctionnement de l’hôpital et peuvent même rendre la justice.
durant le siège d'Alésia était composée de 12 légions, soit près de 70000 légionnaires (dont certains étaient d'ailleurs des gaulois !). Ils parviendront par leur siège à soumettre les 80000 gaulois retranchés dans leur oppidum et résisteront aux 240000 fantassins et 8000 cavaliers de l'armée de secours gauloise.
A chaque légion sont attachés :
un corps de cavalerie de 120 à 300 hommes (dirigé par des décurions et un préfet),
des troupes légères et mobiles recrutées dans les Provinces : les auxiliaires,
des troupes recrutées à la frontière de l'Empire et qui conservent leurs armements et leurs usages de combats : les numéri.
Sous Auguste, le nombre des légions est de 25, soit environ 165 000 légionnaires et autant d'auxiliaires. Le nombre de légions ira jusqu'à 33 sous Septime Sévère.
La fameuse "tortue"
Le principe consiste à opposer à l'ennemi un mur de fer hérissé de javelots, les hommes du 1er rang avancent bouclier contre bouclier,les soldats du second rang se protègent en plaçant leur propre bouclier au-dessus de leur tête.
L'équipement du légionnaire
L'équipement complet pouvait peser de 25 à 40 kg, avec lequel le légionnaire marchait de 25 à 30 km par jour. Cette distance pouvait tripler lors de marches forcées. Cela justifie leur surnom de "mulets de Marius", du nom du général qui réorganisa l'armée sous la République.
L'équipement complet pouvait peser de 25 à 40 kg, avec lequel le légionnaire marchait de 25 à 30 km par jour. L'équipement du légionnaire était composé d'une gourde et d'un sac en cuir, d'une pioche et d'une hache, de ses armes, de son armure ou de sa cote de maille, d'un bouclier, etc. Son habillement consistait en une tunique de laine et de sandales (caligae) .
La tunique grossière du légionnaire était faite de laine. Elle s'arrêtait à mi-cuisse à la manière d'une jupe. Elle tenait le légionnaire au chaud et le protégeait de son armure qui avait des bandes de métal qui pouvaient être coupantes.
Le petit glaive à double tranchant, le gladius, était utilisé lors des violents corps à corps
. Le bouclier romain(scutum) est de forme semi-cylindrique. Sa hauteur est de 1 m 20. La poignée était horizontal et une pièce métallique ronde était fixée devant le bouclier pour protéger la main qui tenait le bouclier.
Le umbo protègeait la poignée fixe et pouvait servir à repousser l'ennemi brutalement. Le casque (galeum pour le casque de cuir et cassis pour le casque de métal) Les casques étaient très équipés. Ils disposaient d'oreillettes de chaque côté de la mâchoire. Une palette disposée à l'arrière du casque servait à protéger la nuque. 5/8 - Fait par : MERTZ Thomas & THOMAS Alexis
Le ceinturon ou cingula est une grande courroie de cuir qui se porte par-dessus l'armure et maintien en place les autres courroies de cuir du balteus et les étuis du gladius et du pugio. Le fameux balteus qui protègeait le bas ventre. Les ornements en métal faisaient du bruit pendant la marche pour intimider les ennemis. Le pilum, lance à pointe de fer, transperçait les boucliers ennemis : il était utilisé au début des affrontements lorsque l'ennemi était encore à distance. La dague ou pugio était aussi porté par les fantassins de la légion romaine.
Le gladius se portait à droite et le pugio à gauche. C'était l'armure la plus populaire auprès des légionnaires romains. Elle était fabriquée de bandelettes de métal maintenues entre elles par des courroies de cuir. Parfois les légionnaires ne portaient qu'une cote de maille (lorica hamata). 6/8 - Fait par : MERTZ Thomas & THOMAS Alexis 4) Les camps Dès que l'armée est rassemblée, le soldat vit à part d
|
|
|---|
|
|
|---|
Les camps romains
Dès que l'armée est rassemblée, le soldat vit à part du reste de la société romaine : il demeure dans un camp construit à l'écart des villes et dort dans une tente construite avec des peaux, donc en cuir. La tente standard a une capacité de 8 légionnaires pour une superficie de 30m2.
Tous les camps sont construits selon le même modèle : de forme carrée ou rectangulaire, le camp est établi à partir de deux axes perpendiculaires, nord-sud et est-ouest, à l'intersection desquels nous trouvons le prétoire, la tente du général et à côté de celle-ci un forum où toute la légion peut se réunir. Le camp est entouré d'un fossé dont la terre est rejetée à l'intérieur : cela forme un talus sur lequel les soldats peuvent planter leur pieux et ainsi former un rempart de bois. À chacun des quatre coins du camp, les soldats fabriquent une tour pour permettre une surveillance du camp.
Le camp est entouré d'un fossé dont la terre est rejetée à l'intérieur : cela forme un talus sur lequel les soldats peuvent planter leur pieux et ainsi former un rempart de bois. À chacun des quatre coins du camp, les soldats fabriquent une tour pour permettre une surveillance du camp.
Ajouter un commentaire